Hope and Glory revient ce soir sur Arte. Nous avions rencontré son réalisateur pour la sortie de sa suite, Queen and Country, en 2015.
Queen and Country a été annoncé un peu partout comme votre dernier film. Alors, c’est vrai ? Vous tirez le rideau ?
Oui. Je crois. Sans doute. Je ne pense pas avoir l’énergie nécessaire pour continuer. Mais bon, regardez Manoel de Oliveira : il a 104 ans et tourne encore, donc je ne préfère pas trop m’avancer…
C’est la suite de Hope and Glory, qui, en 87, ressemblait déjà à un dernier film…
Ahaha ! Vous trouvez ? Vous dites ça parce que j’y évoquais mon enfance et que c’est un sujet de prédilection pour les vieux cinéastes…
Non, c’est un grand film récapitulatif, Hope and Glory. Comme une immense exégèse de votre œuvre. On a d’ailleurs l’impression que vous êtes devenu un autre cinéaste après ça, qu’il scinde votre filmo en deux…
Je ne crois pas que Hope and Glory soit un tournant ou quoi que ce soit. J’ai fait d’autres films très ambitieux après. Mais c’est vrai qu’il y a deux périodes dans ma carrière. D’abord, La Forêt d’Emeraude, Excalibur, Délivrance… Quand je partais à l’aventure et explorais le monde. Aujourd’hui, je fais des films plus contemplatifs. Mais c’est parce que je n’ai plus la force d’aller dans la forêt amazonienne. Alors je voyage dans le temps.
La Forêt d'Emeraude, le bijou de John Boorman
Queen and Country est sans doute ce que vous avez fait de plus drôle…
Je m’intéressais surtout aux ruptures de ton. C’est compliqué à faire, parce que le public n’aime pas être pris par surprise. Je trouve que ça marche pas mal, je suis plutôt content. Vous savez, l’art du cinéma est très difficile à maîtriser. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Dans les années 80, quand David Lean essayait de monter Nostromo, il est tombé malade. Je suis allé lui rendre visite, et il me dit : « J’espère vraiment que je vais me remettre sur pied, parce que ça y est, je crois que j’ai enfin pris le coup de main. I’m getting the hang of it ! » Tous les cinéastes sont comme ça, des éternels débutants.
Pourtant, vous, vous avez très tôt donné l’impression de maîtriser le sujet…
C’est parce que quand on tourne son premier film, on est totalement ignorant. Alors on fonce tête baissée et parfois, ça marche. Le grand risque en prenant de la bouteille, c’est de devenir trop conscient des problèmes qui t’attendent. Et donc trop prudent, trop réfléchi. Il faut savoir lâcher prise. Moi, j’ai parfois été en état de transe sur un plateau. Je tournais des plans, mon chef op’ me demandait pourquoi, à quoi ils allaient servir, je n’en avais aucune idée. Ce n’est qu’une fois dans la salle de montage que je comprenais à quel point c’était un plan crucial, déterminant. Mon subconscient me disait quoi filmer.
Dans les années 70, vous vous tiriez la bourre avec Kubrick pour être le grand cinéaste visionnaire de l’époque. C’était quoi exactement ? Un dialogue ? Une compétition ?
Non, certainement pas une compétition. On s’appelait au moins une fois par semaine. Pour parler de technique, principalement. Kubrick n’était jamais satisfait par le cinéma, toujours frustré par les limites. Il voulait crever le plafond, améliorer les objectifs, la façon d’écrire un script…
William Friedkin nous a dit un jour qu’il n’avait jamais vu un de vos films. Ça paraît surprenant, vu que vous avez tourné la suite de L’Exorciste (L’Hérétique). Vous le croyez ?
Friedkin, en voilà un qui a l’esprit de compétition ! S’il le dit… J’ai quand même du mal à croire qu’il n’a jamais jeté un œil à Délivrance.
On parle du dernier plan de Queen and Country ? Vos débuts dans le cinéma, symbolisés par cette caméra qui tourne…
… Et qui s’arrête. Elle s’arrête et tu meurs.
C’est très beau, parce qu’il y a le début et la fin dans le même plan.
Voilà, c’était ma vie. Une vie de cinéma.
Interview Frédéric Foubert

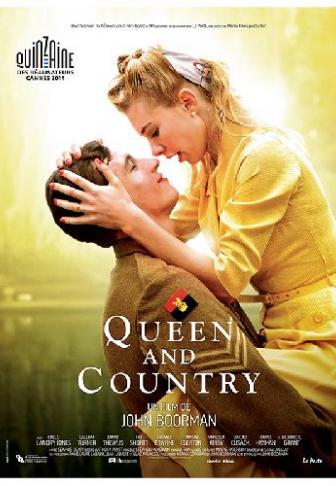

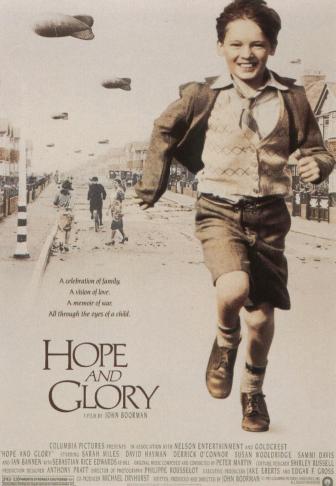





















Commentaires