Le pré-générique
Ça commence costaud. Istanbul, Turquie, un agent blessé, un type à poursuivre à pied, en voiture, à moto, sur les toits, dans les ruelles, sur les trains, au bulldozer. Pour le réal Sam Mendes, le principe est clair : montrer que si il veut, il peut (rivaliser avec la grande geste de la scène d’action bondienne) mais qu’il va s’agir d’autre chose. Montrer les failles chez l’agent 007, prouver que le « permis de tuer » n’empêche pas le risque d’être tué soi-même, ou du moins blessé, y compris dans son amour propre.
Le générique
On note l’absence provisoire du gun barrel, mais le générique touche juste, en multipliant les variations visuelles sur le trou dans la poitrine du héros, duquel son sang s’échappe et par lequel l’œil de la caméra essaye de regarder, pour voir ce qu’il y a derrière la carapace du héros invulnérable. Skyfall sera un voyage intérieur ou ne sera pas.
La chanson
Sous le règne de Daniel Craig, la chanson bondienne jouait jusqu’ici la carte « rock » du moment (l’option Chris Cornell puis Jack White). Or, il se trouve que le plus grand carton de l’industrie musicale internationale 2011 est Adele, adepte britannique du pastiche lounge et des grandes envolées pop. Ni une ni deux, les Broccoli ont sauté sur l’occasion et donné les clefs à la chanteuse, dont le morceau-titre est du bon schmaltz vegassien, avec le degré requis de bombast bondienne mais une voix étrangement sous-mixée.
Les Bond girls
Après tout ça, il faut bien que le film commence. Et que les choses se corsent. Dans le film, les Bond girls se font rares (il y en a plusieurs, mais on les voit peu) pour laisser la place à M, véritable héroïne du film. Mais c’est quoi au juste, une Bond girl ? Une fille avec laquelle Bond couche ? Alors il y en a trois. Une fille dont le drame personnel est lié à l’intrigue principale et au master plan du méchant ? Alors, il n’y en a qu’une, et c’est Judi Dench… Inutile de dire que Roger Moore n’aurait pas fini avec elle dans des draps satinés. Daniel Craig non plus.
Le vilain
Croisement physique de plusieurs méchants du passé bondien (Christopher Lee, Richard Kiel, Christopher Walken), mélange psychologique de plusieurs autres (Sean Bean, le duo gay des Diamants sont éternels), Javier Bardem (notez les initiales) est l’une des vraies satisfactions divertissantes du film. Juste, drôle, timbré et même (un peu) effrayant, il allume un film volontairement terne dès qu’il y pose le pied. Mais il faut attendre 75 minutes…
Le look
Avec Bond, on a le choix. Le choix entre le kitsch 60’s, l’exploitation 70’s, le tourisme jet set années 80, le blockbusterisme lourdaud des années Brosnan ou le pseudo-réalisme Bournesque des deux premiers Craig. Le choix de Sam Mendes s’est porté sur le grand cinéma hollywoodien esthétisant des années 2000 tel que l’a défini un certain… Sam Mendes avec son chef-op’ Roger Deakins dans des films comme Jarhead ou Les Noces rebelles : plans sur-composés, clair-obscur chiadé et balances de point au millimètre. A noter : une grande scène de reflets kaléidoscopiques dans un immeuble vitré qui semble inviter l’esthétique des génériques de Maurice Binder à l’intérieur du film.
L’action
Presque absente. Une fois le pré-générique derrière lui, et en dehors d’un intermède téléfilmé dans le métro londonien, Mendes joue la carte dark et crépusculaire, celle d’un polar clair obscur et sciemment « déceptif » où il n’y a même pas de face à face final entre le héros et le grand méchant. Une leçon retenue après le pétard mouillé de la bagarre Craig/Amalric dans Quantum of Solace ?
Le mythe Bondien
Il y a des clins d’œil, plein. L’Aston Martin, les gadgets, le Martini au shaker (« perfect », dit-il) mais aussi la Heineken à la main (un clin d’œil au sponsor, ça) et le vieux garde-chasse écossais joué par Albert Finney, rôle dont on jurerait qu’il a été écrit pour Sean Connery. Mais pour l’essentiel, Bond est ici engagé dans un retour sur lui-même mélancolique, retour intérieur sur son enfance d’orphelin, que Mendes surligne par la symbolique freudienne des tunnels, souterrains, métro et autres égouts que le héros doit emprunter pour renaître à lui-même. C’est là que le film ressemble le plus aux Batman de Chris Nolan, habités par la même métaphore de l’orphelin qui doit devenir son propre papa.
Daniel Craig
Il est là, physiquement, mais en mode vulnérable, ce qui tranche avec le Terminator blond de Quantum of Solace. Bizarrement, Craig est plutôt bon mais il n’est plus très « Bond », à force de chialer, de souffrir et/ou de regretter dans un plan sur deux. L’option du « Bond humain » montrerait-elle ses limites ?
La suite
James Bond will return, bien entendu. Sur bien des points, Skyfall est un anti-Bond. Volontairement pas fun, ouvertement triste, très (trop) sérieux, il concrétise le fantasme d’un James Bond sans second degré, mais nous ferait presque regretter les bases sous-marines, les maquettes spatiales, les starlettes à monocles et les savants fous en bikini (à moins que ce ne soit l’inverse). A la fin du film, pourtant, il y a une promesse : après trois Daniel Craig (TROIS), tous les éléments bondiens classiques ont enfin été rebootés et remis à leur place, y compris la déco d’intérieur du bureau de M. James Bond will return, donc. Avec le gun barrell et, promet-il, « avec plaisir ». Du plaisir, oui, ce serait bien qu’il y en ait un peu plus la prochaine fois.
Guillaume Bonnet

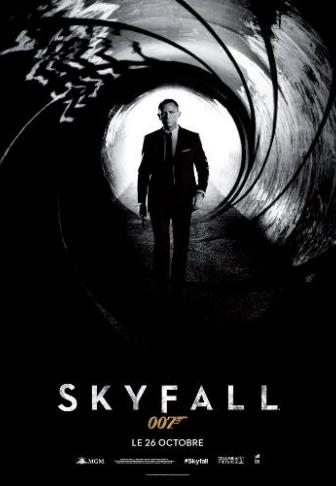


















Commentaires